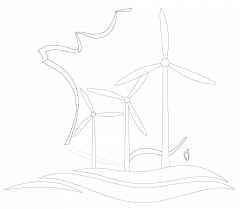Observatoire national de l'éolien en mer
Il est piloté par :
la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du Ministère chargé de l'Energie,
la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires,
la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture (DGAMPA), du Secrétariat d’Etat chargé de la mer
avec l’appui de
l’Office français de la biodiversité (OFB)
de l’Institut français pour la recherche et l’exploitation de la mer (Ifremer).
1. Missions de l'observatoire de l’éolien en mer
L’Observatoire national de l’éolien en mer doit permettre l’amélioration de la connaissance du milieu marin et des impacts des éoliennes en mer, mais également de l’information des parties prenantes, au travers de trois missions principales :
Regrouper, valoriser et rendre accessibles les connaissances qui existent déjà, y compris le retour d’expérience des parcs à l’étranger ;
Acquérir des connaissances complémentaires sur le milieu marin ainsi que sur les interactions entre les éoliennes et la biodiversité marine (y compris la réduction des impacts) ;
Contribuer à définir une méthodologie nationale scientifique pour l’évaluation et le suivi des impacts environnementaux des parcs.
3. Travaux de l’Observatoire
Différents travaux sont menés chaque année depuis l’installation de l’Observatoire en 2022. Ils concernent à ce stade les missions 1 et 2.
Les rapports d’études issus de l’Observatoire seront notamment publiés sur ce site.
L’ensemble des études environnementales menées par l’Etat dans le cadre de la politique de l’éolien en mer seront également mises à disposition sur ce site.